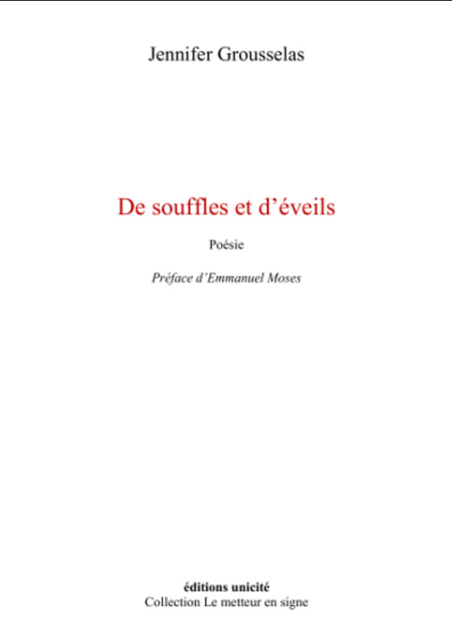
Aux ténèbres du chant-bois dormant
Chant, voix, souffle aux ténèbres. Un seul parcours pour s’élever (s’éveiller ?). Le chant-bois dormant, le Je lyrique bercé, le lecteur pourtant au cœur des ténèbres qui s’étreignent et éteignent à travers le souffle de la dernière flamme de la bougie du temps linéaire.
À nouveau ici les repères du temps et du langage sont bousculés pour être mieux remis. Étrange mystère de profondeur et de clarté que porte De souffles et d’éveils — le premier recueil de Grousselas, mais peut-on vraiment croire qu’il soit précurseur des trois magnifiques recueils à suivre : Corps fou (Le Merle Moqueur, 2024), Il nous fallait un chant (éditions Obsidiane, 2024), Fixation d’un vertige (Éditions sans escale, 2025), vu la lumière qu’il jette sur tant d’énigmes rencontrées dans sa poésie d’après ? Tout se passe comme si les clés n’étaient accessibles qu’en parcourant les questions traversées dans les trois autres recueils car « la bulle rebelle agite / le hochet de sa/ question » (p.84). Un vrai jeu de l’inconscient !
Or, ce qui s’impose à nous avec certitude dans cet étonnant et multiple recueil est l’intensité d’une douleur nette, précise et déchirante, qu’aucune image, fût-elle la plus astucieuse et originale (et chez Grousselas elles le sont toutes), ne peut colmater. Ni avec tact, ni avec des chimères mais avec une poignante lucidité, la poétesse étend les draps vides de Douleur, sur des murs que les fantômes ne pénètrent plus, ceux « d’un inaccessible trou noir » (p. 31) « quand il n’y aura pas de chant / quand il n’y aura pas de langue », d’éveils de vides multipliés qui pleurent des larmes tièdes, « pâles », fraîches.
La rédaction de deux précédentes chroniques sur les recueils Il nous fallait un chant et Fixation d’un vertige de Grousselas, dans un laps de temps de deux semaines, en traversant villes et pays, stylo à la main et recueils dans la poche de ma veste, étonna même Grousselas lorsque je lui fis part de mon travail, comme si traversant pays et deuils, j’avais besoin de garder un bout de cette terre féerique qu’elle évoque, ressasse « quand il n’y aura ni eau douce ni pain / – ni miel ni sommeil ni soleil – » —éternelle errance donc mais vers où et où l’amener ? C’est bien la question qui traque l’absence. Nulle part ailleurs, nulle part chez soi, terre-désert, perte de repères. Or, je m’étais retrouvée avec les quatre recueils de Grousselas en main « dans mes larmes et mon erreur » comme dirait la poétesse, quelques jours seulement après le décès de mon père. Puis, avançant dans mes diverses lectures des recueils : allongée, assise, bras croisés, pieds levés, tête penchée, livres endormis sur ma poitrine tandis que j’écrivais, livres oubliés pendant quelques heures, une contrainte m’y obligeant, ou bien, un trop plein de « trou noir » saisissant m’y poussant, les mots de la poétesse et mon désir de traversées surgissaient comme un appel « du large, du vide » (Nathalie Straseele et Iren Mihaylova, Navigation intérieure), comme des revenants, mais pas comme des fantômes. Comme soleil et chant lumineux. Quelque chose de magnétique mue donc cette poésie, force que j’avais déjà évoquée dans mes chroniques précédentes « L’œil sans visage » et « Il nous fallait un chant pour faire cathédrale même sans dieu » mais sa nature se module dans ce premier recueil, que j’ai lu pourtant en dernier, et qui touche la perte au plus près. Est-ce la maîtrise et l’expérience de poétesse des trois suivants qui ont créé l’illusion d’une distance et d’un écart artistique, qui différencient De souffles et d’éveils des autres recueils ? Est-ce son aspect formel, multiple et éphémère et la puissance de la douleur-douceur évoquée dans ce lieu sans chant et sans langage difficile à pénétrer ? Ce qui m’a semblé le plus juste et le plus surprenant : la poétesse est entrée en matière de douleur et de néant dès ce premier recueil et ce sans aucune honte et précaution comme si dans cette écriture, ce qui venait d’abord était le courage d’exister et l’affirmation d’une singularité telle qu’il serait criminel de ne pas la reconnaître.
Il y a aussi un autre aspect que ce recueil dévoile et que l’on retrouve dans Corps fou (sous une autre forme), c’est bien une sensualité invisible qui prend la forme d’une préoccupation personnelle qui s’étend et s’élargit jusqu’à toucher « l’intime sanctuaire du père invisible » (Cri, Damien Paisant, éditions Bruno Doucey). Ici s’observe indubitablement une poésie pour la poésie et une poésie contre la folie, tout en s’y prêtant, en faisant semblant de s’y mêler pour révoquer, se rappeler, se nourrir « d’un astre mort ».
Il y a ensuite ce que je nommais plus haut, à savoir le retour symbolique à un état de l’enfant (ou « l’infante » (p.38)), retour nécessaire et restructurant semble-il, ici nourrit par l’exploration d’un monde mystico-tragique comme il est souvent le cas dans la poésie de Grousselas, « dans des bois très sombres à la peau très noire » (p.38).
Ressuscité à nouveau, ou comme pour la première fois, le temps dans cette poésie magique a une place particulière. Le temps linéaire suspendu, voire détruit, installe le temps de l’inconscient qui est toujours un temps cyclique, évoqué à travers le sommeil, ainsi qu’à travers les contes de l’enfance : « qu’il dorme (génie de l’arbre) sur son bois chantant / sur moi dormant ». Couronnes d’arbres protecteurs de la forêt, évoquées dans une ambivalence pointue « à la pâleur de fine glace » (quelle magnifique précision !). Il n’y a pas meilleure façon de dire, même si les évocations sont multiples, que le sommeil qui nous enveloppe et nous couve, ce monde mystique d’« étranges lutins », est bien notre berceau et notre tombeau terrestre. Le Je lyrique a-t-il rejoint les morts dans la mort et par là-même accompli un exploit impossible ? Il n’y a pas plus grave terreur et plus profond soulagement que de vouloir son éternel sommeil « au bois chantant/ sur (soi) dormant ».
Il s’ensuit un voyage sombre-lumineux dans une jouissance à retrouver douleur-douceur à travers les méandres des contes-fantasmes pour creuser dans l’abîme l’évocation d’un souvenir, celui de l’espoir qu’il était impossible de cerner auparavant, or, était-il lui aussi endormi pour être mieux protégé, mieux servi plus tard ? Sans doute vient-il comme Grousselas le suggère par souffles, tandis que l’éveil n’est pas un état stable et recherché mais plutôt une succession « d’éveils » —des points de respiration, des retours au « réel » qui ponctuent le sommeil du rêveur, là où naturellement la ponctuation manque car les idées s’enchaînent et s’enlisent dans des sables mouvants. Ici ce qui les éveille et les arrête, ce sont bien les nouveaux souffles (ou les élans dans un langage musical). Étonnamment, l’aspect plus artistique ne tient pas aux images sublimes et surréelles, qui, à elles seules suffisent, mais bien au renouvellement musical, favorisé par l’écriture et la disposition des vers. Finalement, l’idée de la composition s’incruste et s’épanouit à l’intérieur et de l’intérieur, afin de donner naissance au chant. S’agit-il, comme chez Kandinsky, mais encore différemment, de peindre la musique grâce aux souffles et aux éveils, infinis mais inscrits dans une logique intrinsèque, une harmonie propre à la poétesse ! Ce triptyque incarné, écriture, musique et peinture, qui structure certaines poésies, chez Grousselas forme une divine trinité couronnée par l’auréole des arbres-chants (comme dans les icônes orthodoxes en quelque sorte). Divinisation totale de la vie intime et hommage à la subjectivité qu’il serait impossible de séparer dans un art aussi singulier que l’art poétique de Grousselas. Nous ne pouvons qu’espérer continuer de nous émouvoir, pleurer et rire devant la chaude lumière des arbres ténébreux de cette jeune poétesse et peintre aux touches magiques de respiration, que sa poésie soit « multiple et une » (p. 104).
De souffles et d’éveils de Jennifer Grousselas, éditions unicité, 2021, 115 pages. Préface d’Emmanuel Moses.
Chroniqué par Iren Mihaylova
